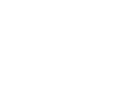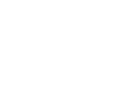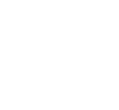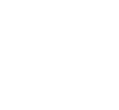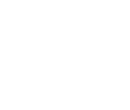Je n’ai pas dépassé l’âge de la retraite, mais je ne suis plus un jeune premier non plus : dans mon environnement professionnel, je rencontre peu de gens qui aient plus de kilomètres au compteur… Vieillir n’a pas beaucoup d’avantages, sauf celui de pouvoir comparer les évolutions de la société.
De l’excellence au no-leadership
Jusque dans les années 70-80 du siècle passé, un employé commençait sa carrière au bas de l’échelle. Pour apprendre le travail aussi bien et aussi vite que possible, il suivait des formations, acquérait de l’expérience et, finalement, était promu et obtenait une voiture de société ! Soudain, il avait des employés « sous ses ordres ». Il commençait alors à « diriger », comme son supérieur l’avait « dirigé » : en donnant l’exemple et en apprenant aux autres comment faire, en les aidant à devenir bons dans leur travail, afin qu’ils puissent à leur tour être promus et que lui puisse encore gravir un échelon. Car personne ne pouvait faire le travail mieux que lui…
Dans les années 80-90, tous les employés devaient devenir « excellents » (Tom Peters) et « leaner », tandis que le « customer is in the centre » car le « marketing is all around you », et il est apparu que ce qui était « good » était le pire ennemi du « great » (Jim Collins). Chaque cadre était un mini-CEO, centré sur sa propre « valeur actionnariale ». Des CEO n’ont pas hésité à proclamer que, selon eux, le client est la clé, alors qu’ils n’en avaient pas rencontré depuis 20 ans, ou que « le personnel est notre atout le plus précieux », après quoi ils lançaient des vagues de licenciements parce qu’ils n’allaient pas atteindre leurs projections trimestrielles.
Au début de ce siècle, le concept de « leader absent » est apparu puis a disparu aussi vite : il a laissé dans son sillage quelques équipes autogérées (qui n’ont réussi que dans des cas exceptionnels), des gens responsabilisés et stimulés – avec, à la clé, un nombre record de dépressions et de burn-outs.
À nouveaux temps, nouvelles exigences
L’éclatement de la bulle Internet, la crise des subprimes et la pandémie nous ont remis les pieds sur terre. Nous avons appris qu’il ne suffit plus d’exceller au travail et d’aider les autres à faire de même. Il faut évoluer, apprendre et grandir en permanence. Et cela ne va pas de soi. Ça requiert des efforts, une dépense d’énergie conséquente. Cette mise en danger, cette volonté de continuer à apprendre par soi-même, est la base du leadership empathique que nous cherchons aujourd’hui. Nous attendons de nos hommes politiques qu’ils fassent preuve de leadership, nous voulons un capitaine que nous suivons de notre plein gré.
Mais comment apprendre cela ? Comment, une fois devenu un expert dans votre domaine (ce qui vous permet d’obtenir une promotion), se muer en leader ? Comment effectuer cette transition ? Comment passer du statut de « responsable » à celui de « responsable de ceux qui sont responsables », comme l’explique Simon Sinek ?
Empathie
La réponse est l’empathie. Pas la sympathie, mais l’empathie. Il ne s’agit pas de faire semblant d’être gentil, mais d’avoir consciemment à cœur l’intérêt supérieur des autres. Lorsque les choses vont bien, couvrez vos employés de fleurs, et lorsqu’elles vont mal, prenez-en la responsabilité. Mettez tout en œuvre pour aider vos employés à mieux faire leur travail – c’est-à-dire non pas à obtenir de meilleurs résultats, mais à mieux se sentir dans leur peau. Ne vous demandez pas comment rendre vos collaborateurs plus performants, mais plutôt comment les aider à se sentir naturellement bien. Aidez-les à voir et à construire le « Better Me » en eux.
Jim Collins expliquait qu’il faut s’assurer que les bonnes personnes soient à bord du bus et seulement ensuite choisir sa destination. Aujourd’hui, il apparaît qu’il faut mettre avant tout les gens dans le bon bus, celui où ils se sentent bien. Il faut créer une atmosphère propice pour que les employés prennent plaisir à travailler de manière optimale. Et c’est ainsi que nous revenons à Tom Peters…